Accueil du site > Maladies > Urticaire & angio-oedèmes > Urticaire chronique : on ne teste pas ! Sauf…
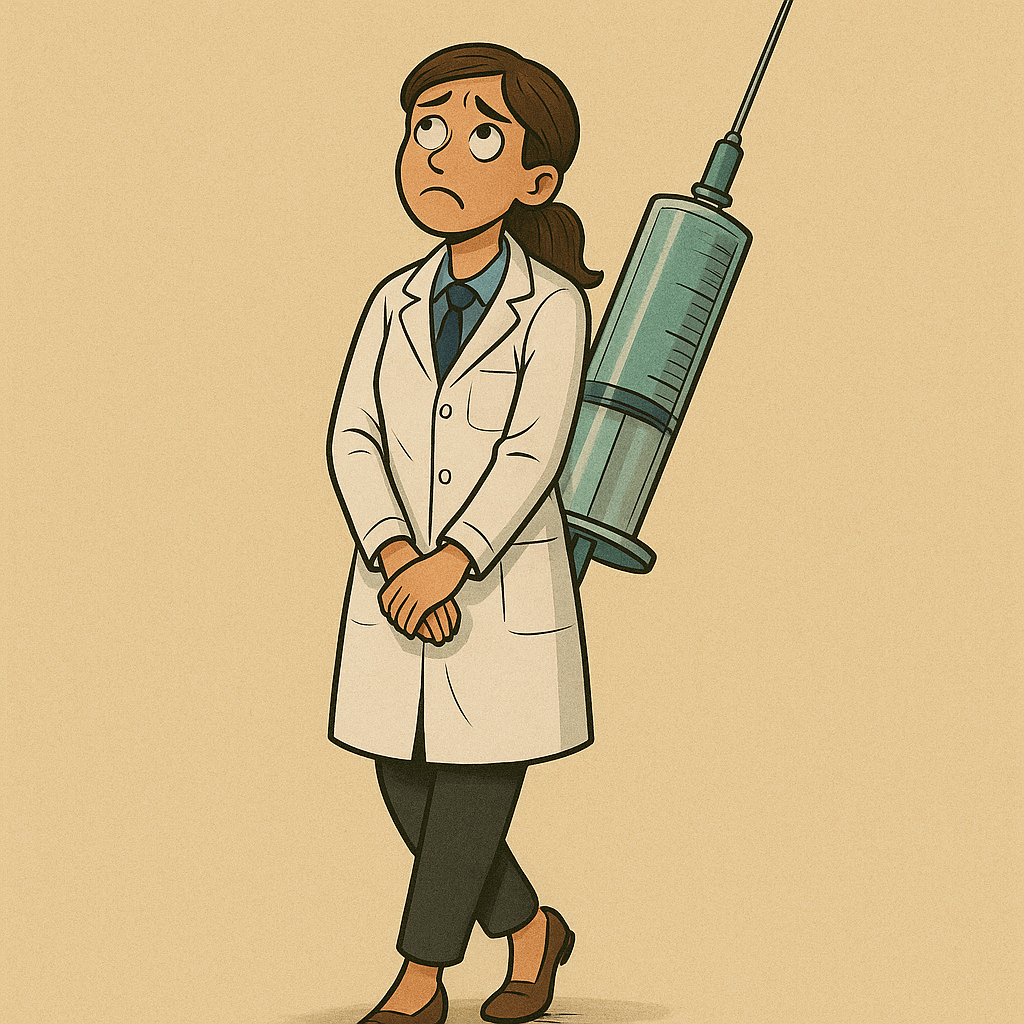
Urticaire chronique : on ne teste pas ! Sauf…
lundi 21 juillet 2025, par
Le traitement de l’urticaire chronique spontanée (CSU) avec ou sans angio-œdème repose sur des recommandations internationales claires, mais la diversité des phénotypes et des endotypes cliniques rend les diagnostics et les thérapies plus complexes qu’il n’y paraît. Alors que les thérapies biologiques ou non, telles que l’omalizumab et la ciclosporine, sont maintenant largement utilisées, une question cruciale reste en suspens : quels tests biologiques peuvent prédire la réponse au traitement et guider le choix thérapeutique ?
Cette revue internationale, pilotée par le comité « Skin Allergy – Urticaria » de la WAO, fait le point sur les prescriptions à effectuer, celles à éviter et celles qui restent possibles dans le cadre du diagnostic initial de la CSU. Diagnostic testing for chronic spontaneous urticaria with or without angioedema : The do’s, don’t and maybe’s Bernstein, Jonathan A. et al. World Allergy Organization Journal, Volume 18, Issue 7, 101068
Méthode
- Analyse globale et synthétique des recommandations internationales (EAACI/GA²LEN/EuroGuiDerm/APAAACI) ;
- Examen des études récentes qui utilisent des biomarqueurs comme critères exploratoires ou prédictifs ;
- Comparaison des pratiques actuelles avec les avancées récentes en physiopathologie et en thérapie ;
- Présentation d’un cas clinique illustrant la prise de décision fondée sur les biomarqueurs.
Pour comprendre les tests évoqués dans l’article :
Résultats
- Il ne faut pas réaliser systématiquement des tests au départ : la CSU est un diagnostic clinique. Un bilan orienté selon l’interrogatoire et l’examen suffit dans la majorité des cas.
- Voici les tests recommandés en cas d’échec des antihistaminiques de deuxième génération (SGAH) :
- Numération formule sanguine (éosinopénie et basopénie sont associées à une forme auto-immune résistante) ;
- CRP, TSH ;
- Dosage des IgE totales, IgG anti-TPO.
- Phénotypes de CSU identifiés :
- CSU autoallergique (type I) : IgE dirigées contre des auto-antigènes (TPO, IL-24…) ;
- CSU auto-immune (type IIb) : IgG anti-IgE ou anti-FcεRIa.
–* Des tests spécifiques, bien qu’utiles, sont rarement accessibles : - BAT (augmentation du marqueur CD203c) ;
- Test de libération d’histamine par les basophiles (BHRA).
- Réponse au traitement selon les biomarqueurs :
- IgE totales > 100 UI/mL : bonne réponse à l’omalizumab, rechute rapide après arrêt ;
- IgE < 30 UI/mL et présence d’IgG anti-TPO → mauvaise réponse à l’omalizumab, meilleure réponse à la ciclosporine.
- Niveaux élevés de D-dimères : cela peut indiquer un CSU grave. L’utilisation potentiellement bénéfique d’anticoagulants ou d’immunosuppresseurs est à considérer.
- Une biopsie cutanée doit être envisagée en cas de présentation atypique ou de suspicion de vascularite urticarienne.
Discussion
- La diversité des phénotypes de CSU nécessite une approche personnalisée : l’uniformité du traitement sans orientation biologique montre ses limites.
- L’exploration biologique ne doit cependant pas être systématique. Elle est pertinente en cas de résistance aux SGAH ou avant l’introduction d’une biothérapie.
- La disponibilité des tests comme le BAT ou la BHRA reste très limitée en dehors des protocoles de recherche.
- De nouveaux marqueurs biologiques prometteurs, tels que l’IL-17, l’IL-31 et l’IL-33, peuvent améliorer la classification future des patients.
- Le coût et l’accessibilité des tests sont des obstacles majeurs à leur généralisation.
- La biopsie cutanée, souvent négligée, pourrait avoir un rôle dans la détection de formes auto-immunes mixtes (éosinophiles et neutrophiles).
Conclusion
L’évolution de notre compréhension de la CSU permet d’envisager une médecine plus précise. Des indicateurs tels que les IgE totales, les anticorps anti-TPO, la CRP ou les tests fonctionnels des basophiles peuvent prédire la réponse à l’omalizumab ou à la ciclosporine. Cependant, ces données ne sont pas encore suffisamment solides pour être intégrées dans les directives de pratique courante. Il est urgent de valider ces biomarqueurs par des études prospectives afin de mieux guider les décisions thérapeutiques en pratique courante.
Ce travail représente une étape importante pour prendre en charge l’urticaire chronique en allergologie. Elle révèle que, derrière une apparente unité clinique, se cachent en réalité des mécanismes immunologiques très diversifiés, exigeant une adaptation des traitements. Pour les allergologues, l’intérêt est double : éviter des explorations inutiles dans les formes simples et cibler avec précision les formes sévères ou résistantes. Il faudra toutefois rester prudent face à l’interprétation isolée de ces biomarqueurs. On devra continuer de s’appuyer sur l’observation clinique, les scores de contrôle (UCT) et l’évolution sous traitement pour ajuster la stratégie. En cela, l’approche proposée rejoint parfaitement les principes promus sur allergique.org, fondés sur une médecine à la fois rigoureuse et pragmatique.
Recevez les actualités chaque mois
